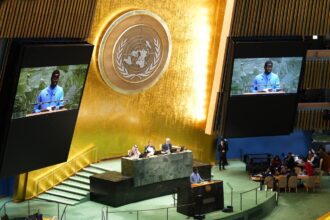L’Assemblée nationale a adopté, le 26 août 2025, une loi encadrant l’accès des citoyens à l’information publique. Un texte salué comme une avancée dans la transparence administrative, mais qui devra faire ses preuves dans l’application.
C’est un texte que beaucoup attendaient. Mardi 26 août, l’Assemblée nationale sénégalaise a adopté à une large majorité la loi sur l’accès à l’information, deux semaines après sa validation en Conseil des ministres. Cette adoption marque une nouvelle étape dans l’agenda gouvernemental en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance.
Derrière la technicité des articles de loi se dessine une volonté politique : permettre à tout citoyen, résident ou structure légalement établie au Sénégal d’accéder à des documents ou données détenus par les autorités publiques, les entreprises parapubliques ou encore les organismes privés chargés d’un service public.
Un nouveau cadre légal et institutionnel
Le texte adopté consacre officiellement un droit à l’information, dans un pays où l’accès aux données administratives est longtemps resté limité, voire opaque. Désormais, une demande d’information peut être adressée à toute entité dite assujettie, qu’il s’agisse d’une institution de la République, d’une collectivité territoriale, d’un ministère ou d’un établissement public.
La loi prévoit également la création d’une Commission nationale d’accès à l’information, autorité administrative indépendante chargée de garantir l’effectivité de ce droit. Composée de douze membres issus de divers corps institutionnels, universitaires ou associatifs, la Commission pourra être saisie en cas de refus ou d’obstruction, préalable obligatoire à tout recours contentieux.
Cette architecture s’inspire de dispositifs déjà en vigueur dans plusieurs démocraties, tout en prenant en compte les spécificités du contexte sénégalais.
Une définition large de l’information communicable
La loi ne se limite pas à la communication de textes administratifs. Elle englobe toute information contenue dans des rapports, bases de données, actes réglementaires, décisions de justice ou contenus audiovisuels. Sont également visés les documents non encore publiés mais déjà finalisés.
L’accès est en principe gratuit, sauf en cas de reproduction. La demande doit être formulée par écrit et motivée, bien que la loi prévoie des dispositions particulières pour les personnes analphabètes ou en situation de handicap, qui pourront formuler leur requête oralement.
En cas de refus injustifié, des amendes allant de 500 000 à 10 millions de francs CFA sont prévues à l’encontre de l’entité fautive. À l’inverse, toute transmission d’informations couvertes par des secrets protégés pourra également entraîner des sanctions pénales.
Des limites inscrites dans la loi
Certaines informations restent exclues du champ d’application. C’est notamment le cas des données relevant du secret de la défense nationale, du secret des enquêtes judiciaires, du secret médical, ou encore de la protection des intérêts économiques de l’État.
La loi prend également soin de préserver des zones sensibles, comme les relations diplomatiques, la sécurité publique ou les processus judiciaires en cours. Ces garde-fous sont censés concilier transparence et préservation de l’intérêt général.
Une avancée saluée mais encore fragile
Pour plusieurs observateurs, cette loi constitue une avancée significative vers une culture de la redevabilité. L’association Article 19, très active sur la question, salue un cadre légal prometteur qui aligne le Sénégal sur les standards internationaux.
Mais la réussite du dispositif dépendra de son application concrète. Il ne suffit pas d’avoir une loi, encore faut-il qu’elle soit respectée dans les administrations, souligne un juriste spécialiste du droit public. La formation des agents publics, la sensibilisation du public et l’indépendance effective de la commission seront décisives.
Une loi inscrite dans une dynamique plus large
L’adoption de cette loi intervient quelques jours après celle sur le statut et la protection des lanceurs d’alerte, votée le même mois. Deux textes complémentaires, inscrits dans une même dynamique de refondation institutionnelle voulue par les nouvelles autorités.
Reste à voir si cette volonté politique s’inscrira dans la durée et si les citoyens se saisiront de ces nouveaux instruments juridiques. Car, comme souvent en matière de droit, tout dépendra de l’usage qui en sera fait.